LA LITURGIE

Châsse reliquaire
- Fin XIIe– début XIIIe siècle
- Cuivre champlevé*, émaux et dorure
- Limoges
Les châsses adoptent traditionnellement la forme d’une maisonnette avec un toit à deux pentes et une crête ajourée au-dessus de celui-ci. Ce toit se soulève donnant accès à l’intérieur et ferme à clef grâce à un moraillon en forme de tête de monstre.
On y renferme les reliques (partie du corps ou objet) d’un saint.
*Le champlevé est une technique qui consiste à ôter un peu de matière pour y incruster de l’émail.
La technique du champlevé :
![]()
Evêques présentant les reliques dans des Châsses
La technique du champlevé :
La technique du champlevé se caractérise par le fait de creuser des cavités (champs) dans l’épaisseur du métal, le plus souvent dans une plaque de cuivre. On remplit ensuite les cavités d’émail (matière vitreuse colorée), tout en laissant un dessin formé par les cloisons du métal dorées au mercure.
Limoges, centre majeur de l’émail champlevé médiéval
A partir du milieu du XIIe siècle, Limoges devient le centre de production majeur d’œuvres en émail champlevé. Les ateliers ont fourni beaucoup d’œuvres, exportées dans toute l’Europe jusqu’au milieu du XIVe siècle.
On parle « d’Œuvre de Limoges » (Opus lemovicense) dans les textes à partir de 1169. Le succès de cette production est notamment dû à la simplicité des matériaux utilisés, peu coûteux (cuivre et verre pour réaliser l’émail), mais qui, une fois mis en forme par les orfèvres limousins, rappellent l’or et les pierres précieuses de par la vivacité des couleurs. De plus, en 1215, le concile de Latran IV autorise l’emploi de l’émail champlevé pour les vases sacrés.
L’œuvre de Limoges est abondante et formée d’une grande diversité d’objets, le plus souvent religieux avec notamment de très nombreuses châsses-reliquaires, mais aussi des pyxides, croix, reliures de livres,… Il est également possible de trouver des objets profanes produits par les ateliers limousins,
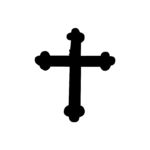
Croix quadrilobée
- Fin XIIIe – début XIVe siècle
- Bois, cuivre champlevé, émaux, dorure
- Limoges
- Ht : 31,8cm
Cette croix de dévotion représente le Christ couronné au centre et les quatre Evangélistes dans les quadrilobes aux extrémités des bras de la croix.
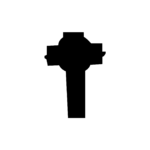
Plaque centrale de croix
- Premier quart du XIIIe siècle
- Cuivre champlevé, émail bleu, vert et rouge, traces de dorure
- Limoges
- Ht. 18,5cm
Cet objet d’art liturgique représente le Christ crucifié. Cette applique était fixée au centre d’une croix.
Le Christ a la tête nimbée légèrement inclinée sur l’épaule droite, l’abdomen gonflé, la jambe gauche fléchie et les pieds écartés.
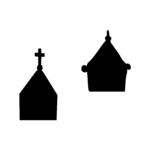
Pyxides
- XIIIe siècle
- Cuivre gravé, ciselé et doré ; émail champlevé
- Atelier limousin
Une pyxide est un petit récipient contenant les hosties pour l’Eucharistie. L’aspect sacré est ici visible avec la croix surmontant l’objet sur l’une d’entre elles, l’autre a disparu.
![]()
Pyxide Helie le Toulousan faisant une conjuration (France, Paris. Bibliothèque de l’Arsenal, 3479 f.592)
Limoges est un centre important pour la réalisation d’objets en émail avec la technique du champlevé. La production, exportée dans toute l’Europe occidentale, débute au XIIe siècle, connaît un vif succès au XIIIe siècle et s’achève au XVe.
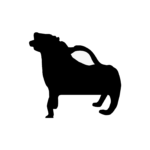
Aquamanile
- XIIe siècle
- Bronze et laiton
- Allemagne du Nord ou Danemark
Un aquamanile (du latin aqua « eau » et manus « main ») est un récipient, souvent en métal, permettant aux prêtres de se laver et de se purifier les mains avant et pendant les offices. D’origine orientale, ce type d’aiguière fut assimilé en Europe au début du Moyen-Âge.
Beaucoup d’aquamaniles ont une forme de lion, comme celui-ci, mais il est possible d’en rencontrer en forme de divers animaux, réels ou fantastiques comme les dragons.
![]()
Besançon BM MS.54 Psalter Bonmont folio 11v-2Germany 1260
L’orifice d’évacuation de l’eau est niché dans la gueule du lion. Un clapet (manquant) sur la tête permettait de remplir le récipient. Une anse représentant un animal est fixée sur son dos et sert de poignée.
 Aquamanile en forme de lion, 1240/1260, bronze, Basse-Saxe (Allemagne), Musée du Louvre.
Aquamanile en forme de lion, 1240/1260, bronze, Basse-Saxe (Allemagne), Musée du Louvre.
L’aquamanile est en bronze fondu, ciselé et gravé. Il a la forme d’un lion, l’anse étant faite d’un petit dragon, courbé en arc de cercle, qui mord le fauve derrière la tête. Le lion, fermement campé sur ses pattes, a la gueule entr’ouverte. La crinière est travaillée en mèches épaisses et souples dont le premier rang dessine une sorte de collerette autour de la tête de l’animal. La queue est cassée. Les larmiers, les moustaches, les naseaux et les ondes du pelage sur les pattes sont soulignés de traits gravés. Un trou, ménagé entre les oreilles et muni d’un couvercle (charnière refaite), servait à remplir le récipient ; l’eau ressortait par le versoir qui surgit du front du lion.
Autres types d’aquamaniles :
Aquamanile dragon
 Aquamanile : dragon couramment appelé griffon, vers 1200, bronze ou cuivre, Basse-Saxe (Allemagne), Musée du Louvre.
Aquamanile : dragon couramment appelé griffon, vers 1200, bronze ou cuivre, Basse-Saxe (Allemagne), Musée du Louvre.
L’aquamanile du Louvre fait partie de la large famille de ce genre d’objets en forme de dragon, produit en Basse-Saxe, notamment à Hildesheim, aux XIIe et XIIIe siècles. Sa tête et sa queue sont celles d’un dragon, avec des oreilles ou aigrettes. Ce genre de monstre est souvent qualifié de « griffon » depuis le XIXe siècle, qui au sens strict désigne un animal à quatre pattes, avec buste et pattes antérieures d’oiseau et partie postérieure de lion. Ce dragon repose quant à lui sur ses deux pattes avant de lion et ses deux ailes à l’arrière.
L’ouverture qui permettait de remplir le récipient a perdu le clapet qui servait à sa fermeture ; la gueule permettait l’écoulement de l’eau. La queue du griffon qui se termine en enroulement végétal forme l’anse.
Aquamanile art déco
 Aquamanile, début du XIIIe siècle, bronze, Allemagne, Musée des Arts Décoratifs de Paris.
Aquamanile, début du XIIIe siècle, bronze, Allemagne, Musée des Arts Décoratifs de Paris.
L’aquamanile du Musée des Arts Décoratifs en offre un modèle significatif et unique : un oiseau fantastique à figure humaine tient de ses deux bras très fins une sorte de goulot faisant office de prise d’air ; une seconde tête d’animal entre les deux pattes fait fonction de bec verseur. Les ailes et la queue de l’oiseau se recourbent pour former l’anse de l’aquamanile et supporter l’orifice à couvercle mobile dans lequel on versait l’eau.
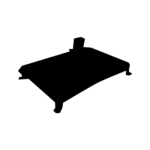
Base de phylactère
- XIIe siècle
- Cuivre champlevé, dorure
- Limoges
Cette base servait à fixer un phylactère, banderole de parchemin aux extrémités enroulées portant les écrits des versets de la Bible. Comme un rappel, les faces de la base sont chacune décorées d’un Evangéliste tenant dans ses mains un parchemin.
![]()
« Réponses à Charles VI et Lamentation au roi sur son état » par Pierre le Fruitier, dit Salmon, 1405-1415
Les évangélistes
Les quatre Evangélistes, Marc, Luc, Matthieu et Jean, auraient écrit les Evangiles, textes relatant la vie et l’enseignement de Jésus-Christ faisant partie du Nouveau Testament (Bible).
Les Evangélistes sont souvent représentés non pas sous forme humaine mais sous forme allégorique : lion pour Marc, taureau pour Luc, homme pour Matthieu et aigle pour Jean.
Ces représentations sont inspirées d’une vision du prophète Ezéchiel dans l’Ancien Testament : quatre créatures célestes identiques dotées chacune de quatre pattes de taureau, de quatre ailes d’aigle, de quatre mains humaines et de quatre faces différentes d’homme, de lion, de taureau et d’aigle. Ces « quatre vivants » ou le Tétramorphe a sa place au pied du trône de Dieu.
Cette vision est reprise dans l’Apocalypse selon saint Jean, mais cette fois les vivants ne sont plus identiques : « Le premier Vivant ressemble à un lion, le deuxième Vivant ressemble à un jeune taureau, le troisième Vivant a comme un visage d’homme, le quatrième Vivant ressemble à un aigle en plein vol.«
Plus tard, ce sont les Pères de l’Eglise, au Ve siècle, qui associent les quatre vivants aux Evangélistes, en fonction de ce qu’ils ont écrit dans leur évangile :
- Marc est associé au lion car son évangile débute dans le désert ;
- Luc est associé au taureau car au début de son évangile il fait référence au sacrifice, et le taureau est l’animal que l’on sacrifiait ;
- Matthieu est associé à l’homme car son évangile débute par la généalogie du Christ ;
- Jean est associé à l’aigle car, dit-on, c’est le seul animal qui peut regarder le soleil sans se brûler les yeux. Il fait donc référence au fait de pouvoir contempler le mystère de Dieu, à l’élévation du Verbe divin et à la prédication de l’apôtre.
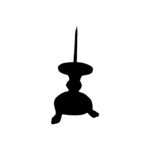
Petit pique-cierge
- XIIIe siècle
- Bronze et fer
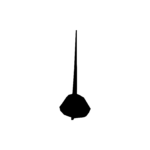
Pique cierge à base hexagonale
- Début du XIVe siècle
- Cuivre champlevé, émaux et dorure
- Limoges
Comme son nom l’indique, le pique-cierge permettait de fixer un cierge tandis que la coupelle récupère la cire fondue.
Celui de forme pyramidale a la base hexagonale décorée d’écus armoriés sur ses six faces.
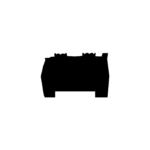
Châsse reliquaire
- XIIIe-début XIVe siècle
- Fer forgé
Ce coffret anciennement polychrome, d’aspect allongé, aux pieds larges et au toit en bâtière, joue le rôle de petit coffre-fort, protecteur du précieux trésor qu’il contenait. Une ancienne et intéressante réparation à l’arrière, indique que la châsse a été forcée pour être probablement pillée de ses reliques. L’aspect primitif de ce reliquaire permet de penser qu’il fût réalisé pour une modeste chapelle.

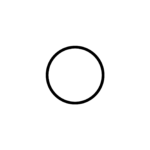
Bague
- XVe ou XVIe siècle
- Laiton ?
- Don de Pierre Malrieu
Bijou avec l’inscription IHS gravée.
IHS est le monogramme du Christ que l’Eglise latine a interprété Iesus, Hominum Salvator soit « Jésus, Sauveur des Hommes » mais qui tient son origine des trois premières lettres du nom grec de Jésus.
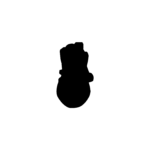
Ensemble d’ampoules de pèlerinage
- XIVe siècle
- Plomb
Les ampoules de pèlerinage sont des fioles dans lesquelles les pèlerins pouvaient ramener de l’eau bénite, de l’huile sainte ou encore des reliques de leur pèlerinage (terre, bois, tissus…). Les anses permettent de les suspendre au cou ou de les fixer sur leur couvre-chef.
Elles peuvent être décorées de fleurs de lys et en forme de bourse ou de coquille faisant référence au pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. La coquille reste l’emblème du pèlerinage en général au Moyen-Âge.
Ampoule de pèlerinage à décor de fleur de lys...

- Epoque médiévale
- Plomb
- Ht. 5,6cm
- Don de Pierre Malrieu
Ici ornée d’une fleur de lys, elle était portée autour du cou au moyen d’un cordon noué au niveau des anses, elle contenait de l’huile sainte ou de l’eau bénite mise au contact de reliques.
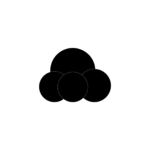
Ensemble d’un plat et de trois bassins d’offrandes
- Autour de 1500
- Laiton
- Nuremberg, Allemagne
Usage diversifié selon la présence de décor ou non et de sa thématique. Ces plats n’étaient pas exclusivement réservés au service du culte, ils pouvaient aussi être utilisés comme réflecteur de lumière ou comme élément décoratif. Ici, thématique religieuse donc destinés à transporter le pain ou l’hostie lors des baptêmes ou communion ou encore pour la quête d’argent.
Plat avec l’Agneau pascal :
L’Agneau pascal est un symbole religieux fort qui, pour les chrétiens, représente Jésus-Christ, l’ « Agneau de Dieu », qui s’est sacrifié pour racheter les péchés des Hommes (en référence à l’agneau qui était un animal sacrificiel). L’adjectif « Pascal » fait référence à Pâques, moment où le Christ est passé de la mort à la vie en ressuscitant.
L’Agneau pascal est ici représenté avec une auréole et portant une bannière, comme cela se retrouve beaucoup au Moyen-Âge.
Bassin d’offrande avec Adam et Eve :
D’après la Genèse de la Bible, ils sont le premier homme et la première femme créés par Dieu. On les voit ici dans le Jardin d’Eden, de part et d’autre de l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal. Ils ont chacun dans la main un fruit défendu, tandis que le serpent, symbole du Mal tentateur, est enroulé autour du tronc de l’arbre. Cet épisode, fondateur dans la Bible, causera la chute des Hommes, condamnant les hommes à travailler avec peine le sol et les femmes à enfanter dans la douleur.
Bassin d’offrande avec la grappe de Canaan :
Dans la Bible, Canaan désigne la terre promise aux Hébreux par Dieu. Moïse y envoie des messagers pour explorer Canaan qui reviennent avec une énorme grappe de raisin qu’ils transportent à deux au moyen d’une perche.
Bassin d’offrande avec l’Annonciation :
Ce plat représente l’Annonciation, lorsque l’Archange Gabriel vient annoncer à Marie qu’elle est enceinte, que l’enfant s’appellera Jésus et qu’il sera le Messie. Cet épisode est donc très important pour la religion chrétienne et est très souvent représenté de la même manière : à gauche d’archange Gabriel, à droite Marie et au-dessus la colombe du Saint-Esprit envoyant ses rayons puisque Marie est enceinte « par la vertu du Saint Esprit ».

